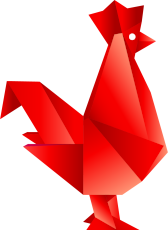Take Off / BeTomorrow, l’histoire d’une reprise par Alexandre Ribeiro

[L’interview Take Off] Embauché par la grâce d’une méprise en 2003, Alexandre Ribeiro a débuté en tant que stagiaire chez BeTomorrow. Franchissant étape par étape, il en est devenu le CEO, puis également le propriétaire de cette agence de création, design et développement il y a quelques mois. Dans cette interview long format, il revient sur les mécaniques qui ont conduit à cette opération.
Le take off, c’est « l’entrée en vague » dans l’univers du surf : le moment où l’on quitte la position allongée pour se mettre debout et accélérer. L’interview Take off de La French Tech Bordeaux, c’est un éclairage sur la phase de décollage des entreprises prometteuses de notre territoire. En face à face, dirigeants et dirigeantes nous livrent leurs fondamentaux, leur vision, leur business model. Comment ils prennent la vague, en somme.
BeTomorrow, qui emploie plus de 80 collaborateurs, fonctionne comme une startup et s’est notamment spécialisée dans le développement d’applications mobiles, de jeux et de lancements de produits. Elle n’hésite pas non plus à développer ses propres plateformes, comme récemment avec Skillagora, solution dédiée à l’animation du partage de compétences entre pairs.
Comment es-tu arrivé chez BeTomorrow ?
Alexandre Ribeiro : C’est un peu du hasard. En 2003, l’informatique ne va pas super bien, et encore moins à Bordeaux. C’est le moment où je termine mes études à l’Enseirb, tous mes potes partent en stage à Paris. Moi, le stage que je trouve, c’est dans cette petite boîte qui comptait 5 ou 6 personnes à l’époque. Il n’y avait ni Apple, ni les stores, ni le GPS dans les téléphones. A l’époque il n’y a pas une centaine de personnes qui travaillent en France sur les applications mobiles. C’est vraiment une niche et personne ne se dit que c’est quelque chose d’avenir et que ça ferait des milliards de dollars dans le monde entier.
J’ai été recruté sur une petite erreur, on va dire. Il y a un autre Alexandre qui avait passé les tests techniques. Alexandre Jubien, qui a monté le mobile ensuite chez Deezer, et qui a fait son stage chez BeTomorrow mais qui est parti après. Quand j’ai appelé l’entreprise pour savoir où en était ma candidature, « bonjour c’est Alexandre, etc etc », on m’a répondu que c’était ok et que je pouvais venir signer. Et je suis rentré dans l’entreprise comme ça, grâce à une erreur de prénom. Je n’ai pas fait les tests techniques, c’est l’autre Alexandre qui les a passés. Mais ils nous ont gardés tous les deux en fin de compte. Quand ils se sont rendus compte de la boulette, ils ont vu que je sortais de l’Enseirb, ils aimaient bien l’école, mon profil était cohérent. Ils ont tenté le coup.
Tu sentais déjà des prémices de ce marché mondial ?
Non, pas du tout. On a souvent envie de regarder le parcours réalisé en se disant qu’il y a un fil conducteur mais non, pas cette fois. J’étais dans l’instant présent, celui de réussir mon stage de fin d’études. A l’époque BeTomorrow faisait du jeu mobile multi-joueurs et était hyper en avance sur le marché. On avait cette vision un peu startup : on était tout petit, avec des deals ambitieux passés avec des acteurs plus gros que nous, on bossait beaucoup, on allait manger au restaurant universitaire à Pessac, on était post-étudiants.
« Développeur est un métier plus concret qu’on l’imagine »
Comment as-tu évolué à l’issue de ce stage décroché sur un malentendu ?
Les fondateurs, Jean-Dominique Lauwereins et Sylvie Clin, font le choix de me garder. A l’école, je m’ennuyais un peu. Chez BeTomorrow, c’était tout autre chose. Développeur est un métier plus concret qu’on l’imagine. A la fin de la journée, tu vois concrètement le fruit de ton travail. J’étais à fond dedans et j’ai fait du développement pendant deux ans. L’avantage d’une toute petite structure comme BeTomorrow à l’époque, c’est qu’on y fait forcément plein de choses. Je me suis vite occupé du Mobile World Congress pour Alcatel. On faisait des innovations pour eux. Ce sont des responsabilités qu’on ne m’aurait jamais confiées, à 23 ans, si j’étais arrivé dans une boîte de 200 personnes. On s’occupait de la moitié du stand d’Alcatel lors de ce salon qui s’appelait à l’époque 3GSM World Congress.
Etre sur ce type d’événements, en France ou à l’étranger, me permettait de prendre du recul et revenir avec une liste d’idées. J’ai commencé à proposer des choses, la réponse des fondateurs a été : « Pourquoi pas ? » Je m’attendais à leur donner des recommandations pour qu’ils le fassent, la douce naïveté des débuts (rires). Mais ils m’ont mis en responsabilité.
Ils t’ont donné le cadre pour le faire…
Oui, mais il faut bien comprendre ce qu’on entend par cadre. Ça n’implique pas toujours les moyens : les budgets, les personnes, les formations… donc ça a mis du temps. Il y a des choses qui ont mis des années à se concrétiser, l’agilité par exemple. Trois ans plus tard, on a travaillé avec des Canadiens et on l’a vraiment travaillé, ça a eu un impact énorme ensuite.
A quel moment a germé l’idée de reprendre Betomorrow ? Qui est à l’origine de l’idée ?
L’idée vient de moi. Il y a eu, un jour, une discussion ouverte avec Sylvie, Jean-Dominique et une de nos banques, sur les évolutions futures de l’entreprise. Spontanément, la personne s’était tournée vers moi pour savoir si ça m’intéresserait de reprendre la société. Complètement hors sujet à ce moment-là, je lui ai dit non. On envisageait de s’adosser, je me suis dit qu’elle avait craqué ! C’est plus tard que j’ai compris que ça évoluerait. On est en 2019, je me suis tracé différents avenirs potentiels, j’étais salarié. Ce que j’avais le plus envie de faire, c’était de piloter une boîte comme BeTomorrow.
J’en ai d’abord parlé à ma compagne qui s’est montrée de suite ultra motivée. En décembre 2019, j’en ai parlé aux fondateurs. On est avant le premier confinement, ça n’a pas aidé ! Je leur ai demandé si ça pouvait les intéresser, j’étais loin de faire une offre. A ce moment, Jean-Dominique passait à autre chose, il était à fond sur Dronisos (startup réalisant des spectacles de drones, NDRL), Sylvie continuait son rôle de directrice des affaires financières. Quant à moi, j’étais CEO depuis l’année précédente, j’étais déjà sur la stratégie, les recrutements, le positionnement… Ils m’ont dit pourquoi pas, mais je pense qu’ils y croyaient encore moins que moi. Je me doutais bien qu’ils n’allaient pas me brader le fruit de 20 ans de leur travail, et je ne le leur demandais pas non plus. C’est là que j’ai commencé à me renseigner.
Quelles difficultés as-tu rencontrées ?
La question de la confidentialité n’est pas simple à gérer. Ils connaissent tout le monde, je n’ai pas envie de faire courir des bruits malgré moi, qui pourraient arriver aux oreilles des collaborateurs, des clients… Il n’était pas question de déstabiliser qui que ce soit. Pendant trois mois, j’ai cherché de l’information un peu partout. C’était aussi une période où BeTomorrow retrouvait une forte croissance.
LMBO, pour leveraged management buy out : j’ai mis deux mois avant de trouver le mot qui correspondait à ce que j’avais en tête. Et si ça porte un nom, c’est que ça existe ! « Le guide pratique du LBO » est un bouquin qui m’a pas mal aidé et fait progresser sur certains sujets, la dette mezzanine, l’importance du cash flow… Finalement je suis tombé un jour sur une professionnelle bordelaise, Isabelle Arnaud-Despréaux (associée gérante de MBA Capital, NDLR), avec qui les choses ont rapidement avancé.
« Être le candidat parfait n’est pas nécessaire »
Quand on porte un projet de reprise de ce type, est-on vite rattrapé par le syndrome de l’imposteur ?
Des doutes, on en a toujours. Je n’étais pas la personne parfaite pour ça, je n’avais jamais réalisé d’opérations de ce type par le passé, mais j’ai compris qu’être parfait n’est pas nécessaire. Il y a plein de gens qui font des LMBO pour la première fois et ils le font bien. Mais il me fallait convaincre et donc faire l’inventaire de mes atouts.
Je suis passé par plusieurs postes chez Betomorrow, c’est une expérience précieuse qui apporte une bonne compréhension des enjeux. La greffe peut être plus compliquée avec un profil extérieur : on a connu à plusieurs reprises des arrivées à des postes clés de Betomorrow de profils expérimentés, de haut niveau, venant de TF1, d’Alcatel… Et ça n’a jamais complètement pris. On a essayé plusieurs fois, avec des gens supers, bien meilleurs que moi, alors chef de projet, sur un certain nombre de sujets. Eux, ils essaient de déployer de la stratégie commerciale et moi, qui n’étais pas commercial mais toujours au contact des clients partenaires, signais davantage de deals. Avoir fait du développement, du management, de la vente… pendant tant d’années chez Betomorrow présente forcément des avantages. Mais je n’ai pas de doute sur le fait que quelqu’un qui en 20 ans, aurait dirigé 4 entreprises différentes, aurait lui aussi eu des arguments.
J’apprends encore. Par exemple, j’ai eu mon premier conseil d’administration en décembre dernier. Je suis un « noob du CA », je n’ai pas trouvé ça si formel que ça. On y construit un projet, c’est en fait assez proche de ce qu’on fait pour un client.
Comment as-tu « vendu » ton projet de reprise aux investisseurs ?
J’ai construit le projet de manière assez similaire à ce qu’on fait quand on monte quelque chose pour un client : rassembler les atouts, montrer qu’on a anticipé les points négatifs, en m’inspirant de présentations de haut niveau auxquelles j’avais pu assister par le passé.
Ces dernières m’ont fait découvert l’inverse de ce que j’avais toujours lu. La présentation de plus haut niveau que j’ai vue, c’était celle de Jean-Luc Constanza (directeur d’Orange Vallée, filiale de l’opérateur Orange destinée à l’innovation, de 2007 à 2013), qui voulait monter un projet d’innovation assez immense. La présentation était courte, assez moche, et hyper négative 80% du temps. Voilà les problèmes qu’on va avoir, voilà les challenges, les difficultés, les oppositions… Je m’en suis inspiré, sans aller jusque dans ce pessimisme quand même (rires) !
Ma présentation incluait notamment le sujet de la résilience de l’entreprise, qui a vécu des crises, des réorientations. J’ai construit la présentation autour de l’envie, le pourquoi, le projet, les difficultés, les hypothèses de croissance et pourquoi elles sont défendues. J’avais un atout : les chiffres, je ne les ai pas appris par cœur, je les ai vécus de l’intérieur. Bosser sur le rachat m’a forcé à les regarder avec le regard d’un fonds d’investissement. Et ça n’est sans doute pas étranger aux plus de 35 % de croissance enregistrés en 2022.
On a itéré avec Isabelle Arnaud-Despréaux et son équipe sur le plan. Ça m’a poussé à inclure des parties pas évidentes, le marché concurrentiel par exemple. Ensuite, ils ont pris les contacts avec les investisseurs potentiels, pour des questions de confidentialité. Après un premier filtre, j’ai pitché le projet à une quinzaine de fonds d’investissement, et ensuite auprès de 6 ou 7 banques. A la fin j’ai refait le même pitch mais cette fois devant les salariés de l’entreprise, après m’être accordé avec les cédants. J’ai envoyé le business plan écrit à toute l’équipe et j’ai proposé à ceux qui le voulaient de se retrouver un vendredi matin pour écouter mon projet et passer sur le grill des questions.
Le sujet de la valorisation peut générer de la friture sur la ligne avec les fondateurs. Comment as-tu géré ce thème et ces intérêts potentiellement divergents ?
On a d’abord négocié avec les cédants et une fois la LOI signée, je suis allé voir plusieurs fonds. Il faut faire un petit pas vers les cédants, puis vers les fonds qui ont dit pourquoi pas, puis encore vers les cédants pour s’entendre sur un prix. A ce moment, je n’étais toujours pas intimement sûr que ce soit possible.
C’est une négociation et chacun a ses arguments. J’aime bien le concept d’agent, qu’on voit beaucoup dans le sport par exemple. Amener un tiers dans l’équation permet de dépassionner et de dire les choses de manière cash au représentant des cédants. Ce n’est pas magique mais ça enlève bien 80 % des difficultés et cela permet de maintenir une relation en bon état si l’opération ne se fait pas.
« Fautes d’infos, on peut passer à côté de beaux projets »
Est-ce que tu as eu la possibilité de choisir les investisseurs ?
Au début pas du tout. En discutant avec les fonds, il y a eu des moments de creux et de doutes, des refus, des semi-propositions. Mais ils sont quand mêmes alignés et quand le premier répond positivement, les autres suivent souvent. Fin 2021, le tour de table ne collait pas. Mais quand les chiffres de l’année tombent et qu’on dépasse les objectifs, ceux avec qui on discutait disent oui. J’ai choisi sur les conditions du deal mais aussi le relationnel.
Pour les banques, c’était pareil. Dès qu’une d’entre elles m’a fait une bonne offre, tout le monde a suivi.
Une fois le projet ficelé, comment se déroule l’annonce aux salariés ?
Quand le process a avancé et qu’il devenait relativement certain, je l’ai annoncé à certaines personnes-clés de l’entreprise, qui allaient être sollicitées pour les audits. Puis à tout le monde car tous doivent être consultés avant la fin de l’opération. On en a alors parlé ensemble avec Sylvie, tout en expliquant que les cédants réinvestissaient, marquant la continuité mais aussi un nouvel élan. Les collaborateurs ne s’y attendaient pas… pas plus que moi quelques mois auparavant.
Je leur ai passé la même présentation que celle montrée aux fonds et aux banquiers, en enlevant une seule slide : celle de la valorisation. Le projet a été super bien reçu. La transparence soulève forcément des questions, de bonnes questions : il faut l’assumer derrière.
Que retiens-tu de l’opération et de sa mise en place ?
Le plus décisif, c’est l’accès aux infos. La première information que je n’avais pas, c’est que le projet était techniquement possible. J’ai compris en montant l’opération qu’on peut faire plein de choses sans forcément avoir beaucoup d’argent de côté, qu’on peut finir en étant majoritaire. Faute d’infos, on peut passer à côté de beaux projets.
Les précédentes interviews Take Off

Comment Little Worker construit des fondations solides

Aucoffre, fier d’être en marge

Données personnelles : comment SFBX cherche à rétablir la confiance

Comment Geosat concilie hyper croissance, prudence et audace

Pourquoi AT Internet fusionne avec Piano

Lucine : « Le nombres d’acteurs des thérapies digitales explosent »

Après avoir levé 20 M€, quel futur pour Tehtris ?


« Les réseaux sociaux vont vers une guerre de la précision de la donnée » (Stéphanie Laporte, Otta)